|
La Télévision braconnière : le téléspectateur et les données des réseaux sociaux
|
|
|
Article, D'Un Ecran à l'autre, les mutations du spectateur, Les Médias en actes, L'Hrmattan / INA, juin 2016
 
Le téléspectateur a pu être qualifié de
"braconnier", au sens où il reconstruirait ses propres interprétations,
à partir de l'offre de programmes, en fonction de ses propres intérêts.
Or, l'accès aux programmes audiovisuels via internet lui permet de
construire directement sa demande, voire de complètement
"désintermédier" les chaînes. Mais en retour, il fait connaître ses
propres centres d'intérêt, devient observable, visibilité à la base de
nouveaux modèles économiques, comme celui de Netflix : c'est la
télévision qui, maintenant, "braconne" ces données.
|
|
Prisonnier d'une série télévisée
|
|
|
Article, Ecrans 4, Analyser les séries télévisées,
Classiques Garnier, avril 2016
  
La série Le Prisonnier présente des singularités qui permettent de
l’utiliser comme un modèle pour l’analyse des moteurs narratifs des
séries, notamment d’un point de vue méta-générique. Elle préfigure la
plupart des combinaisons narratives qui pourront être actualisées dans
les séries télévisées. En particulier, elle met en abyme la
condition ambivalente des séries, entre plaisir de la répétition,
intimité et proximité, contre enfermement dans des rôles et
assujettissement à des rendez-vous.
|
|
Répétition et développement des figures
introductives dans Goldorak
|
|
|
Communication, présentée dans le
cadre du colloque GOLDORAK
[le colloque -- 40 ans
après]
 
Ircav / Gric - Université Sorbonne Nouvelle
- Paris 3, Maison de la recherche,
18 mars 2016
Quand
on compare les séries pour enfants aux programmes pour adultes, la
durée des éléments répétés d’un épisode à l’autre est particulièrement
frappante. Dans Goldorak, ces éléments itératifs contribuent
certainement au plaisir du programme, en permettant au jeune spectateur
d’anticiper certaines actions. D’autres éléments sont purement
répétitifse, mais participent aussi au plaisir rituel de l’attente et
de la reconnaissance de ces séquences. Or, on retrouve des séquences
comparables de transfert ritualisé des personnages vers leurs vaisseaux
dans la série Thunderbirds (S. et G. Anderson, 1966), dont l’économie
intègre aussi, dès sa conception, des produits dérivés, sous forme de
jouets reproduisant les véhicules utilisés par les personnages de la
série. Ces séquences contribueraient donc à la mise en phases qui
permet aux jeunes spectateurs de rentrer dans la série. Les jeux de
rôles, créés par les enfants à partir de ces programmes, ou les jouets
dérivés, n’en seraient donc pas que des conséquences secondaires, mais
bien le cœur de leur principe de fonctionnement : une forme
d’initiation à ce qu’est une fiction, par l’expérience réitérée du
plaisir de la transition vers un monde fictionnel, codé et ritualisé.
|
|
L'incipit des séries télévisées, modèle fini d'un
monde infini
|
|
|
Communication, présentée dans le
cadre du colloque « Troubles en séries, les
séries à l'âge adulte »,

Marge - Université Jean Moulin - Lyon 3, 14
janvier 2016
Les
débuts d’une série doivent répondre à des objectifs multiples : mettre
en place un ensemble de contraintes d’écritures, un système de
répétition et de variation, proposer l’adhésion à un contrat de
lecture, forcer le début d’un engagement pour le spectateur, fixer la
possibilité d’un regard en commun et de communautés de vision.
Leur étude peut permettre d’appréhender simultanément des questions
esthétiques et des questions narratives, voire des questions de
production et de réception.
|
|
Six Feet Under, "au-delà" du mélodrame
|
|
|
Contribution à un ouvrage collectif, Médias et
cultures en dialogue,
L'Harmattan, collection Audiovisuel et communication, janvier 2016


« Au-delà » de la subversion du modèle
narratif du mélodrame, la série Six feet Under, centrée sur le devenir
d'une
entreprise familiale de thanatopraxie et d'accompagnement funéraire,
produit un récit unifiant, construisant
une métaphore de ce que serait la fonction même d’une série
télévisée :
produire des récits unificateurs, quelque soit l'inacceptablilité de
leurs prémices.
. |
|
Le documentaire militant, une comédie ordinaire ?
La trilogie de Pierre Carles, entre documentaire, autofiction et comédie
|
|
|
Communication, présentée dans le
cadre du colloque international « Comédies françaises
contemporaines : nouveaux enjeux, nouvelles approches »,

Studies in French Cinema - University of
Surrey / Ircav, Paris, 12 juin 2015
Si la comédie est un genre protéiforme, peut-on y
inclure l’autofiction, quand son auteur se met en scène, et utilise les
ressorts de la comédie pour, à la fois, mettre à distance son objet, et
emporter l’adhésion du spectateur ?
Entre documentaire militant, autofiction et comédie réflexive, ces
films mettent en question les limites des genres, et la fonction du
rire, oppositionnel, libérateur ou résigné. |
|
Quand un film en cache un autre. The Curious
Adventures of Mister Wonderbird contre Le Roi et l'Oiseau
|
|
|
Communication, présentée dans le
cadre du colloque international«
La Mort des films »,

Kinétraces / Ircav / Afrhc, Paris,
7 mai 2015
La genèse du film Le Roi et l'oiseau est
particulièrement bien documentée : à la suite d'un différent avec le
producteur, l'auteur, Grimault, perdra ses droits sur le film initial,
La Bergère et le ramoneur.
Il parviendra néanmoins à reprendre son film, et à imposer sa version,
effaçant celle du producteur. Pourtant, celle-ci continuera de circuler
aux États-Unis en version anglaise, jusqu'à trouver une nouvelle vie
sur les plateformes : archive.org, You Tube, Amazon. |
|
Thomas, le petit train de l’animation. De
l’animation-temps à l’animation-mouvement
|

|
Communication, présentée dans le
cadre du colloque international
«
La qualité de l'animation à la télévision, entre économie et esthétique
»,

Labex Icca / Ircav / Ensad / INA, Paris,
7 novembre 2014
Dans le programme pour enfants Thomas et ses
amis, inspiré des Railways Series, les mouvements
sont figurés uniquement par l’agencement temporel des
locomotives, qui n’ont aucune possibilité de véritablement agir, ne
pouvant que se déplacer sur des rails, en respectant des horaires. Le
passage à l’animation numérique permettra de figurer les capacités
sensorimotrices des personnages. La série Chuggington
inverse ainsi complètement le
rapport des personnages-locomotives à leur corporéité : ils ne
subissent plus des déplacements qu’ils croient maîtriser, mais doivent,
au contraire, apprendre à contrôler leur propre corps pour réaliser des
manœuvres, initiées par leur volonté – un passage de
l’animation-temps à l’animation-mouvement.
|
|
La part du spectateur
dans la télévision sociale
|

|
Communication, présentée dans le
cadre du colloque international «
D'un écran à l'autre. Les mutations du spectateur »,

Cemti / UQAC / INA, Paris, 23 mai 2014
Si la fonction de la télévision est
de pouvoir en parler, et donc de socialiser, les réseaux sociaux
prolongent et démultiplient ces interactions. Or, les audiences,
l'artefact qui permet de quantifier les spectateurs, risqueraient de
cette façon de se " désagréger " : comment vendre un " temps de cerveau
disponible ", maintenant qu'il devient évident que le spectateur fait
tout un tas d'autres choses ? La référence aux série sur les réseaux
sociaux manifeste ainsi une forte conscience de cette socialité par les
spectateurs, avec ses formes de politesse, au sens fort du terme, comme
la prohibition du spoil. Du côté des acteurs économiques, la notion
d'engagement remplacerait alors celle d'audience, au risque de faire de
la télévision un second écran, celui des réseaux sociaux.
|
|
Socialité en série. La Réception des séries
télévisées par les étudiants en cinéma
|

|
Communication, présentée dans le
cadre du colloque international «
Jeunes : acteurs des médias »,
 

Centre d'étude sur les jeunes et les médias /
Geriico / Elico, Lyon, 11 avril 2014
Les étudiants en cinéma
ont-ils une relation particulière aux séries télévisées ? Comment les
réseaux sociaux interviennent dans les pratiques d’usage des étudiants
? Cette approche qualitative montre l'importance des transmissions, et
la place de l'expertise propre aux étudiants en audiovisuel dans
l'usage social des séries.
|
|
|
La Fonction culturelle du commentaire
sportif
|
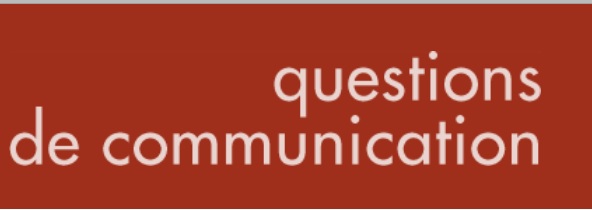 |
Actes, dans Spectacles sportifs, dispositifs
d'écriture. Questions de communications,
série actes 19, Éditions universitaires de Lorraine - PUN, 2013.
  
La fonction du commentaire serait de
permettre
aux retransmissions sportives de devenir des objets d'échanges
sociaux et de profits symboliques, ce qui justifiera l'implication du
téléspectateur dans le programme.
|
|
|
D’Adorno à la reconnaissance culturelle
des séries
|

|
Communication
présentée dans le cadre de la journée d’étude « Médias et
Cultures en dialogue », Faculté des Lettres et Sciences
Humaines,

Université Catholique de Lille, département
Médias Culture et
Communication, Lille, 5 avril 2012.
L’analysedes
séries télévisées permet de questionner la dimension
familiale et religieuse du mélodrame, tout en dépassant ce schéma à la
fois idéologique et narratif : une série comme Six Feet Under
joue avec les codes qu’elle
instaure, les personnages agissant autant en fonction du savoir
spectatoriel que de la logique de l’univers narratif, comme s’ils «
connaissaient l’histoire ». Cette série intègre ainsi des références à
une
culture télévisuelle qui irait de l’art vidéo aux televenovelas,
contribuant à constituer cette culture et à la faire reconnaître.
|
|
Construction énonciative et qualification
culturelle des spectacles sportifs
|

|
Communication
présentée
dans
le
cadre du colloque international « Dispositifs d'écriture
des spectacles sportifs »,

Centre de recherche sur les médiations,
Université de Lorraine, Metz,
10 décembre 2010.
Aborder
les retransmissions sportives, en particulier de football, comme une
chaîne énonciative complexe, qui va du jeu lui-même aux commentaires en
réception, en intégrant le processus de mise en forme télévisuelle -
dont les commentaires télévisés, permet d'en préciser les enjeux en
terme de qualification culturelle.
|
|
La
« longue queue » sans la tête : paradoxes de la
diffusion pirate des œuvres audiovisuelles en Chine
|
 |
Communication
présentée
dans
le
cadre du colloque international « Piratages audiovisuels. Les réseaux
souterrains de la mondialisation culturelle
»,

Institut français de Presse, Université Paris
2, Paris, 18 juin 2009.
La diffusion souterraine de biens culturels,
presse, livres, musique, vidéos, a pu, historiquement, permettre de
contourner des censures, en particulier les censures d’États
totalitaires.
Or, l’État chinois semble parfois instrumentaliser l’économie
souterraine pour en faire une arme de chantage et de censure financière.
La notion controversée de « long tail » se verrait ainsi
illustrée par un paradoxe : les œuvres étrangères, y compris les
plus improbables, sont disponibles sur les marchés souterrains, tandis
que la diffusion pirate permet de décapiter les recettes domestiques
des coproductions internationales, si elles contreviennent aux canons
politiques. |
|
|
|
L’usage politique du spectateur :
contrôle des médias et évolution du droit
|
|
|
Communication
présentée
dans
le
cadre du colloque international « Nouveaux médias et information :
convergence et divergence »,

 
Université Panteion, Athènes, Grèce, 7 mai
2009. Actes publiés en avril 2010.
À l’occasion de la convergence des médias, des évolutions
majeures sont apparues dans le droit français et dans le rapport du
gouvernement aux institutions judiciaires : faut-il y voir une
adaptation nécessaire du droit à des formes de dématérialisation de la
délinquance ? Les arguments politiques qui soutiennent ces
évolutions sont extrêmement liés à l’actualité, à l’information
diffusée par les médias, en premier lieu la télévision, et à ses
logiques rhétoriques propres, comme la mise en avant des victimes. La
question demeure de savoir si les nouveaux médias, en décloisonnant les
positions d’auteur et de lecteur, de sujet et d’objet, ouvrent de
nouveaux espaces démocratiques et culturels, ou si l’inquiétude, face à
cette ouverture, ne sert qu’à justifier la contention d’institutions
qui auraient de plus en plus besoin de la répression pour se maintenir.
|
|
L’oralité dans les films de Pierre Carles,
stratégie de contournement des interdits méta-discursifs de la
télévision
|
|

|
Communication
présentée dans le cadre du colloque international « Pratiques
orales du
cinéma »,


Université de Montréal, Canada, 27 octobre
2007.
Les films de Carles réintègrent, sans cesse,
leur propre écriture, les traces des effets qu’ils produisent,
inscrivant directement dans leur forme, par le biais de l’oralité, les
difficultés de leur énonciation. Sortes de films « boule de
neige », ils intègrent systématiquement les réactions
télévisuelles et orales qu’ils entraînent. L’oralité, en accompagnement
d’un film, et intégrée dans un film, peut donc, dans certains cas,
apparaître comme une stratégie permettant de contourner
l’intransitivité fondamentale de la télévision, tout en mettant
celle-ci en évidence.
Or, l’économie de la télévision reposerait
sur l’illusion de l’inverse.
|
|

|
|
Télévision et convergence des médias ; 2000-2005 : vers
un nouvel espace public ?
|

|
Thèse soutenue le 13 septembre 2006, Sorbonne, Paris.
 


Publiée aux éditions de l'ANRT
en 2008.
Le principe de la convergence ou de l’intégration
des médias, alliance de technologies autrefois séparées et association
de capitaux attribués précédemment à des activités distinctes,
constitue un fait de discours, utilisé par les acteurs du secteur
audiovisuel pour désigner l’évolution de cette activité.
S’agit-il de la simple invocation d’une mana permettant de justifier
des stratégies économiques peu claires, ou assiste-t-on à une
transformation profonde des médias audiovisuels, à un changement de
leurs modalités de fonctionnement, y compris au niveau textuel ?
Quelles sont alors les conséquences de la
dématérialisation des contenus sur la structure de l’Espace public, les
institutions de régulation, les normes d’acceptabilité et l’autonomie
des champs culturels audiovisuels ?
La thèse est organisée en cinq parties, abordant successivement les
aspects symboliques, communicationnels, économiques, réglementaires et
légaux de la Convergence par rapport aux spécificités des industries
culturelles, et en particulier de la télévision, avec un horizon
esthétique et politique.
|
|
Combinatoires et variables
dans les séries télévisées
|
 |
Contribution,
groupe de recherche "Télévision art populaire" Ircav, Université Paris
3, 1er juin 2006
Regarder une série télévisée, malgré les apparences, n’est
pas un acte anodin : c’est un investissement temporel lourd, un
engagement qui durera parfois plusieurs années. Les séries ne peuvent
donc être comprises sans les resituer dans les économies sociales et
les structures de discours dans lesquelles elles s’intègrent, afin de
rendre compte des combinatoires qui assurent l’articulation entre
propositions esthétiques, économie des modes de diffusion et usages
spectatoriels.
|
|
Le spectateur,
fiction de la signalétique
|

|
Communication, Journées d’études Assic “Figures du
spectateur”, 21 mai 2005.

Actes diffusés par l’Assic,
Université Paris III
La signalétique anti-violence du CSA vise à protéger les
enfants, et à responsabiliser les familles. Mais cette attention au
spectateur et aux enfants ne cacherait-t-elle pas un déficit de
crédibilité structurel de la télévision ? Ainsi, ces mesures de
précautions ne feraient que naturaliser le postulat de ses effets et la
mutualisation possible de la disponibilité des spectateurs – et masquer
la réalité des détournements d’usage dont peut témoigner, notamment,
l’espace artistique.
La « dangerosité » de la télévision conditionne en effet son intérêt
politique…
|
|
Étude sur les
marchés et les
festivals audiovisuels
|

|
Contributions,
Équipe d’étude Ircav, Université Paris III, 1999 - 2008
Compte-rendu Input 2004, Barcelone
Les marchés, les
festivals et les rencontres audiovisuelles
ne sont pas seulement des lieux de visibilité et d’échange des
programmes, mais aussi de développement des discours, d’observation des
stratégies de légitimation et d’exposition des axiologies propres au
champ télévisuel. Cette étude, menée en équipe depuis 1998 à travers de
nombreuses manifestations en France et à l’étranger croise analyse des
programmes, des programmations et des discours, expérimentant à travers
des partenariats durables avec leurs organisateurs la complexité de la
production d’un discours d’objectivation sur la télévision.
|
|
Convergence des médias,
divergence des discours
|

|
Présentation
des attendus et des finalités du travail de
thèse

Journées doctorales de la Sfsic
du 18 & 19 janvier 2002, Celsa, Neuilly
Présentation des communications diffusée par le Celsa et la Sfsic,
Atelier d’édition du Celsa
Est-ce que l’hypothèse de Mc Luhan se vérifiera, les médias
informatiques réalisant les potentialités libératrices des médias,
encore latentes dans les médias électroniques. Au contraire, comme le
soutien Castells, relèvent-ils de modes d’expressions différents, aux
conséquences distinctes en terme de structuration sociale ? Un
intérêt pour les phénomènes conjoncturels d’intégration des médias peut
amener à aborder les paradoxes des discours sur la télévision. En quoi
celle-ci peut-elle relever d’une esthétique autonome, si on la
considère toujours en termes d’effets aliénants ? L’occurrence de
ces questions n’amène t-elle pas à l’envisager non comme une
esthétique, mais comme une poétique, une matrice générative dont les
contraintes constituent les moyens et les ressources du plaisir de la
performance spectatorielle.
|
| |
|
Internet : le public,
messager d’un nouvel espace
|

|
Communication,
Journées
d’études Assic “Le Messager”. Paris 18 & 19 mai
2001

Actes diffusés par l’Assic,
Université Paris III, Service de reprographie de la Sorbonne Nouvelle
Les portails audiovisuels et multimédia, entités et procès
de communication nouveaux entre diffuseur et récepteur, induisent de
nouvelles conditions d’accès aux programmes. Leur devenir en tant
qu’entités éditoriales s’est avéré incertain, les modèles de public
admis pour la télévision semblant inopérants dans le cas des nouveaux
médias. Est-ce qu’un nouvel espace public se dessine, ou au contraire,
les présupposés des théories critiques de la communication ne
servent-ils que d’argumentaires aux groupes économiques qui
entendraient imposer leurs propres cadres de régulation des discours et
de dérégulation des marchés ?
|
|
Conditions énonciatives du
commerce électronique
|

|
Article, Cahiers du Circav n°12
« Multimédia » Gérico, Université Lille III,
2000

 
Le télé-achat relève-t-il d’une finalité ou d’un usage par
défaut des nouvelles convergences ? A partir des questions de
détermination technologique et d’indétermination des usages, cet
article propose, au vu de l’évolution économique du secteur et de
l’information économique véhiculée par ses agents, de s’interroger sur
les conditions énonciatives de ces processus de communication et leurs
conséquences sur le médium télévisuel.
|
|
Télévision et intégration des médias :
quelles ruptures pour quelle transformation
|

|
Présentation des objectifs et de la méthodologie du
travail de thèse

Journées doctorales de la Sfsic
du 4 février 2000, Université d'Avignon
Le discours sur l’évolution de
la télévision remplit indiscutablement en lui-même un certain nombre
d’objectifs pratiques, tels que convaincre des partenaires économiques
du bien fondé d’une politique industrielle. Cette évolution proclamée
est relayée par les médias, ce qui entraîne des effets de mode
directement observables, et donne matière aux arguments de vente des
produits et services en relation avec l’audiovisuel. Aussi on peut se
demander si cette évolution modifiera notre objet d’étude – la
télévision – avant même que celui-ci n’ait été circonscrit de façon
satisfaisante.
|
|
Les spectacles
sportifs : approche énonciative et culturelle
|
 |
Contribution, 1999. Séminaire
de recherche sur la télévision “Le Sport et la télévision” Ircav / Ina
A partir d’une typologie des différents spectacles sportifs
et de ses conséquences en terme de représentation, de communication et
de qualification culturelle, ce texte propose d’envisager le sport à la
télévision comme un système énonciatif complexe où l’énonciation
elle-même structure la narration et détermine les positions de
réception.
|
|
Le producteur et les bergers
|

|
Contribution, 1998 / 1999. Equipe de recherche sur les archives du Crédit
National, Ircav / Bifi

Le film La Bergère et le
ramoneur, de Paul Grimault, constitue un cas unique de production
étalée sur plus de 30 ans, et un exemple de montage budgétaire très
particulier dans le contexte économique de l’après-guerre, avec le
problème du contrôle des changes.
Les procès en paternité qui suivront, entre producteur et auteurs,
s’inséreront dans une période où ces rôles vont voir leur statut
juridique évoluer et se stabiliser.
|
|
Télévision et discours
critique, l’énonciateur télévisuel en question
|

|
Mémoire de DEA soutenu en 1998

Université de la Sorbonne Nouvelle
La télévision fait régulièrement l’objet de polémiques.
L’objet de ce mémoire est de préciser leur implication dans la façon
dont la télévision peut se construire, se perpétuer et se renouveler,
en se demandant si ces termes critiques peuvent effectivement
constituer des concepts productifs pour la compréhension du
fonctionnement textuel de la télévision.
|
|
Télévision et produits dérivés
|

|
Note
conjoncturelle, 1998. Séminaire d'étude
“Stratégies des entreprises dans les secteurs cinématographiques et
audiovisuels” Ircav
Cette note présente le poids économique des produits dérivés
et leur importance dans les stratégies d'évolution des chaînes.
|
|
Fonctions & limites de
la mise en abyme
|

|
Contribution, 1997. Séminaire de recherche sur la
télévision
“La mise en abyme de la télévision par elle-même” Ircav / Ina
Ce texte propose, à partir des
multiples formes d'abyme à la télévision et des scandales qu'ont pu
susciter un certain nombre d'entre elles, de considérer le rôle
fonctionnel de la mise en abyme dans les limites tracées par ses
écarts. Question d'ordre énonciatif, impliquant un type de contrat de
lecture particulier, la mise en abyme constitue l'image que la
télévision entend donner d'elle-même, en même temps qu'elle donne ses
propres clefs de lecture. Le mode d'interaction figuré à la télévision
par la mise en abyme procède ainsi d'un dispositif de légitimation,
indispensable à l'établissement de sa crédibilité, en intégrant la
conscience qu’a le spectateur du dispositif télévisuel.
|
|
Le cinéma comme
contre-fantasme publicitaire
|

|
Mémoire de maîtrise, 1996

Université de la Sorbonne
Nouvelle
Mémoire sur les réactions de la critique aux films de Besson
et Blier et son rôle dans la légitimation du cinéma par sa distinction
des formes publicitaires.
|
|
Nikita, une esthétique
publicitaire de la peur
|

|
Dossier d'étude, 1996
Université de
la Sorbonne Nouvelle / Université Panthéon Sorbonne
Analyse du film Nikita , précisant les facteurs d'angoisse,
leur origine et les moyens de leur résolution. Le film apparaît alors
comme une métaphore de la communication opposée à la création
artistique.
|
|
Analyse rédactionnelle du magazine Entrevue
|

|
Document commandité de pré-étude marketing, 1995
Texte destiné à préciser les modes rhétoriques
employés par le magazine et les limites propres à son concept à partir
de l'analyse des contenus rédactionnels d'un numéro.
|
|
Analyse narrative de l'émission Cluedo
|

|
Document d'étude marketing, 1994
Utilisation de méthodologies d'analyse narrative
pour afiner l'adaptation d'une émission de télévision.
|











